Chapitre 2 – milieu. Je lui raconte que j’envoie des images…
Dans le jardin du musée, (et pas celui de Belfiori ni de Finzi Contini qui devient ma chaloupe, ma carrée, mon Manhattan bien glacé) je déjeunai selon mes rites de solitaire désœuvré : pain aux olives, trois tomates trop peu mûres, yaourt à boire- hélas goût pomme verte, rien d’autre à la Coop en passant. Puis je somnolai un peu, devenu lézard immobile.
Silvia ( mais je l’ignorais encore) servait à elle-même un Lambrusco très rouge, très rude, très froid. Rien de tel pour de chaleureux échanges
(Auto-portrait soir sans visiteur, photo Silvia B.)
Je sais maintenant, à mon âge, qu’une insouciance volontaire serait la meilleure façon d’avancer vers une sortie sans façon, la fin de la visite, de la sieste, de la journée, du voyage, hop, Ciao pantin mal articulé, on quitte le guignol léger, de plus en plus léger, me voilà ombre de jardin, pliure d’un plan de Ferrare, brisure de marron glacé dans un sorbet caramel vendu via Carbone, éclat de brume sur les rondeurs de La Mura, hop, arrivederci. Je m’efforce de m’effacer de mes propres souvenirs. Pas si facile.Surtout que j’essaie cela depuis environ soixante ans.
Mais le désir de savoir s’impose sur la liberté d’oublier.
Le gardien, dont le révolver trop lourd pendait à la ceinture relâchée, s’approchait et me regarda : réveillé, j’écrivais ces notes. Lui aussi n’était pas un jeune homme. Il avait soixante ans, au moins, sa lassitude l’exprimait autant que la fatigue des épaules. Chez moi ce sont les rides au visage. La sueur colorait son uniforme aux couleurs un peu incertaines, entre gris mauve et brun clair, on se demande avec quelle substance hallucinogène on a pu rêver ça. Mais d’autres sont ici passés rêver le vrai.
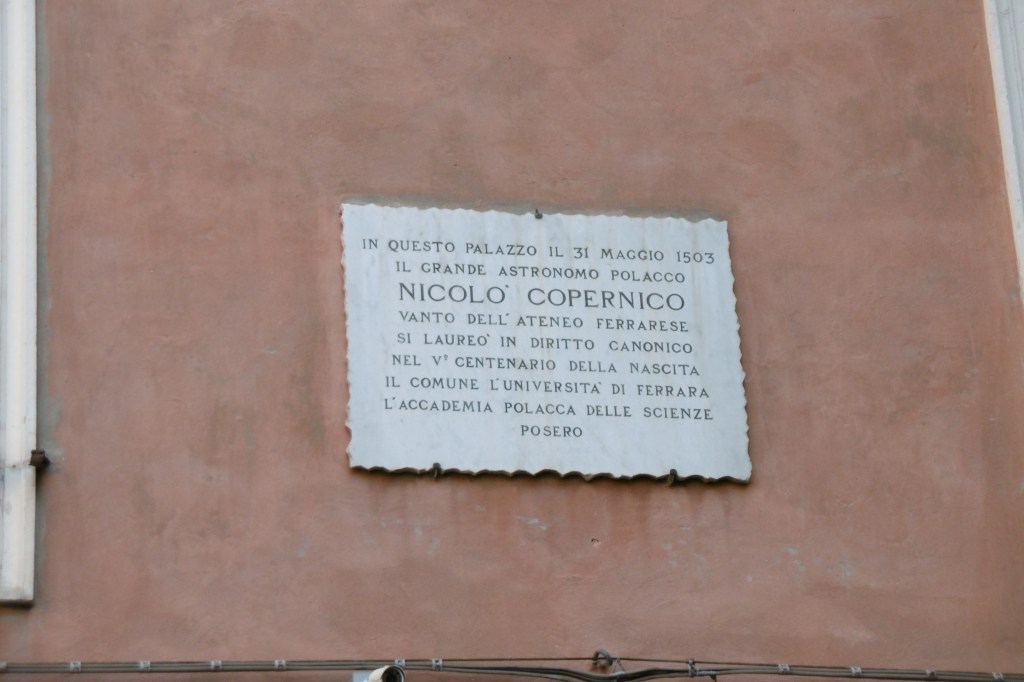
Il m’observe, à quelques pas, comme on ferait dans un roman, encore étonné que mes poches contiennent tant d’objets, tous miniaturisés comme le sont parfois les histoires, et cela suffît pour écarter la tentation de l’effacement, la vocation du repli qu’insufflent tous les musées. Je vois à son visage qu’il me faudra, maintenant, lire « Le jardin » de ce vieux Giorgio, à la lumière de ce que le musée dans la ville m’apprend, pas seulement sur les jardins et les gardiens, les souvenirs des Anciens et les verres pour rien, la Renaissance et les Résistants.

Quand je me lève pour partir, je traverse un bref instant d’étourdissement. Le gardien demande si « tuto bene », car le mouvement est un peu mouvant, je me suis redressé trop vite ? Age et soleil, on ne se méfie plus assez, ni l’un ni l’autre ne se regardent de face, selon un autre duc. « Scusi », je me suis un peu absenté de moi-même, je me suis une seconde installé dans une fissure de la mémoire, un peu comme une envie urgente, mais tic-toc me revoilà. Il voudrait savoir, à présent, je le vois, savoir quelque chose de moi, de qui, de ça ?
Savoir sur moi. Toujours cette ambition et toujours sa déception.
En quelques mots je raconte : je visite, je prends des notes et des photos, j’explore sans exposer, je rédige peut-être, parfois, de moins en moins, la notice que n’exige plus l’Agence. Par pudeur je lui cache que j’ai pris ma retraite. L’explication le satisfait d’autant qu’il fait trop chaud pour approfondir quoi que ce soit, même pas les invraisemblances. Juste on se parle pour parler parce qu’on est de la même humanité. Ici, dans ce musée justement, ça ne veut pas rien dire, la même humanité. Le mot même : humanité.
De sorte que tout est parfait dans le jardin le mieux cultivé du monde.

De nouveau, je marche sans malice dans la ville. A Ferrare, le plus difficile est d’échapper aux vélos voraces vélocement vêtus de vives jeunes filles volubiles, silencieuse menace soudain découverte sur chaque trottoir, mais il y a des menaces sans vrai danger, sauf d’en avoir peur.

Pendant la visite du Castello, peu après, la surprise vient de la cour d’honneur. On y répète la Tosca, qui sera donnée ce soir, dans la même cour.
 Tout le monde est en costume de rien : le ténor porte un jeans 51 trop serré, et ne retire ses mains des poches arrière que pour les notes les plus basses, les plus difficiles. Trois ou quatre parmi les musiciens consultent leurs messages pendant les courtes pauses ou hésitations du jeune chef d’orchestre : Oui, j’ai pensé à appeler mamie, t’inquiète, bisous. N’oublie pas tes devoirs de maths, mon pinson.
Tout le monde est en costume de rien : le ténor porte un jeans 51 trop serré, et ne retire ses mains des poches arrière que pour les notes les plus basses, les plus difficiles. Trois ou quatre parmi les musiciens consultent leurs messages pendant les courtes pauses ou hésitations du jeune chef d’orchestre : Oui, j’ai pensé à appeler mamie, t’inquiète, bisous. N’oublie pas tes devoirs de maths, mon pinson.
LA REPETITION : toujours mieux ensuite, on croirait une devise de boy-scout. J’essaie cela pour mes « notices », sans y croire.


 Une harpiste, genre anorexique mal guérie et comme maquillée en préraphaélite, on se demande si elle va pas se glisser entre les cordes, perdue vers les bas des tribunes, vérifie avec soin le vernis de ses ongles.
Une harpiste, genre anorexique mal guérie et comme maquillée en préraphaélite, on se demande si elle va pas se glisser entre les cordes, perdue vers les bas des tribunes, vérifie avec soin le vernis de ses ongles.
Je me demande si Ferrare n’est pas qu’un décor ?
Puis, soudain, tout chante et tout s’émeut, comme si la représentation s’osait, Nike aux pieds, chemises largement ouvertes, et on ne dit rien de ses dessous, à la Représentation ( du monde comme volonté ?), tout ça n’est pas très net, pas franchement mauvais genre, « Tosca », mais on se demande si la harpiste – une harpie et pis ! – ne porte pas un string noir pour aller sortir ce soir, déguisée en ongles rouges ?

Les batteries de l’iPhone sont épuisées, trop de photos et de chaleur. Dans la ville, je marche au jugé. En route, un verre, et somme toute, j’erre. Je me perds dans les ruelles. Le plan de Silvia, gribouillé, disloqué ne peut que favoriser les disparitions du sens. Au coin du Corso Gioveca une flèche indique les cimetières, et je sais que l’un d’entre eux doit être visité pour ses arcades, son portique, enfin quelque chose de ce genre- qui ressemblerait à celui parcouru à Zagreb un après-midi d’automne : vigne vierge aux roux mêlés, lumières atténuées, passages furtifs d’ombres imprécises ?

La via delle vigne, bien plus loin me conduit, en fait, sans que je l’aie choisi, devant le double portail du Cimitero Ebraico. Entre deux hauts piliers de béton brut, le double battant métallique, peint de gris, affirme la violence subversive d’une entrée de camp, comme par une horrible dérision, involontaire mais brutale.

Angles de fer forgé imprévu, comme d’aigles menaçantes. Je sonne à la porte latérale. Personne ne répond.
C’est samedi. Plus de batterie, j’aurais pourtant voulu envoyer une image aux amis de Paris, Moscou, Washington, Cécile, Sergi, Mark.

J’avoue, venir visiter le cimetière juif un samedi, faut être un peu con.
______________________________________________________________________
Didier Jouault pour YDIT-suit : Le Jardin de Giorgio Bassani, épisode 7/99, Chapitre 2 – milieu. Je lui raconte que j’envoie des images…En réponse à une sympathique mais ferme interpellation : NON, « ça » n’ira pas plus vite. On a le temps : quatre-vingt-dix-neuf séquences.
A suivre...
On a le temps, On est à la retraite (ça finira par se savoir)
J’aimeJ’aime
Et tout tu te caches vraiment bien et loin
J’aimeJ’aime
Et toit tu te caches vraiment bien et loin 😇🙏🏻
J’aimeJ’aime